

"Les 14 obus tirés du Tardenois, sur Paris, par le "Pariser Kanone"", le 15 et 16 Juillet 1918"
V - Pont de Chemin de Fer

La 63ème D.I., du 29 Juillet au 2 Août, malgré certains succès locaux, dont l'un rapporta un bon lot de prisonniers au 216e, ne progresse que lentement. Le débouché sur la rive droite de l'Ourcq défendue par une ligne de mitrailleuses remarquablement organisée, nécessite de nouvelles journées de sévères combats (ferme Corbeau, le pont du chemin de fer). Ce n'est que dans la matinée du 2 août que l'ennemi se dérobant enfin à la pression de la 63ème D.I. celle-ci put entrer dans Saponay.
Le 3 Août retrait du front. La 63ème DI est dissoute après ces combats compte-tenu de ses pertes
Cette voie ferrée a vu passer deux convois ferroviaires, aller-retour, en juillet 1918, un pour la pièce du bois du Châtelet dont nous parlerons cet après-midi et un pour la pièce qui va s'installer dans le Bois de Bruyères. Rappelons nous que nous nous intéressons, aujourd'hui, aux obus tirés le 15 et 16 (ou 16 et 17) juillet 1918, sur Paris et que le 305ème R.I. reprend le secteur 10 jours plus tard, donc la pièce du Bois de Bruyères a été démontée et évacuée précipitamment.

Informations extraites des recherches de Jean Hallade, présentées dans son livre "De l'Aisne on bombardait Paris".
"Si l'avance des troupes françaises partant de la Forêt de Retz, c'est-à-dire franchement vers l'est, avait été légèrement plus rapide, elles auraient fait une capture sensationnelle.
Tiré par une locomotive, un convoi exceptionnel sur voie ferrée quitte la région de Fère-en-Tardenois où en deux jours cette " Bertha " vient de tirer 14 obus sur Paris. Le temps presse et la plate-forme métallique n'a pas la possibilité d'être démontée. Les 260 tonnes de cet ensemble, affût-truk et canon, ne se déplacent pas comme un canon de campagne et les difficultés commencent. C'est très lentement que le convoi remonte vers Soissons alors que se déclenche vers l'est l'offensive française, c'est-à-dire en direction de la voie ferrée Château-Thierry - Soissons (pour la pièce du bois du Châtelet) qu'emprunte le canon. Saconin, Mercin-et-Vaux, Missy sont rapidement occupés à moins de 5 km de la voie ferrée où le mystérieux canon tente de gagner Soissons (hypothèse peu probable car entre l'Ourcq et Soissons la voie ferrée est celle d'un tramway et donc inutilisable pour des wagons à écartement normal). Ecoutons ce que dit un officier remontant avec le canon : " Nous sommes amenés à pousser notre canon par chemin de fer jusqu'à Soissons (c'est à dire par Fère-en-Tardenois, Mont-Notre-Dame) où nous trouvons seulement l'aiguillage nécessaire pour sortir du triangle peu rassurant (le triangle Fismes - Château-Thierry - Soissons) par le sud du Chemin des Dames. A Soissons les choses vont assez mal. Le canon français se rapproche et on ne peut pas dire combien de temps nos troupes pourront tenir encore contre des forces trop inégales, mais l'officier qui commande le détachement réussit à faire traverser Soissons par le canon sans trop de heurts et à le ramener vers l'arrière malgré toutes les difficultés ".
Soissons est repris par les Français le 2 août à 18 heures, mais le canon géant est passé. Les Français ont manqué de bien peu un exploit dont on aurait parlé longtemps.
Après Soissons on perd la trace du canon, mais il est probable que c'est vers Laon qu'il est remonté pour regagner l'un des emplacements du 23 mars dans la forêt du Mont de Joie."
Si nous regardons vers l'est nord-est, nous voyons Fère-en-Tardenois et devinons sa gare. En 1918 la gare de Fère est immense car les quais et les entrepôts s'étendent jusqu'à Saponay.
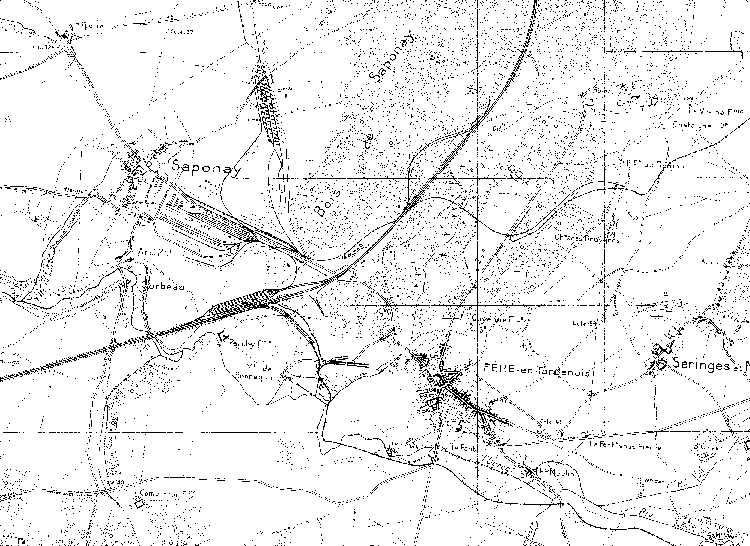
VI - Le Pariser Kanone

Informations extraites des recherches de Jean Hallade, présentées dans son livre "De l'Aisne on bombardait Paris".
" Les tirs sur Paris avec les pièces d'artillerie de type "Pariser Kanone" ont été dénombrés.
Les quatre séries de tirs ont été les suivantes :
1ère série, du 23 mars au 1er mai : 185 coups.
2e série, du 27 mai au 11 juin : 104 coups.
3e série, les 15 et 16 juillet : 14 coups.
4e série, du 5 au 9 août : 64 coups. "
Les informations suivantes proviennent du site :
http://html2.free.fr/canons/index.htm. Merci à son auteur.
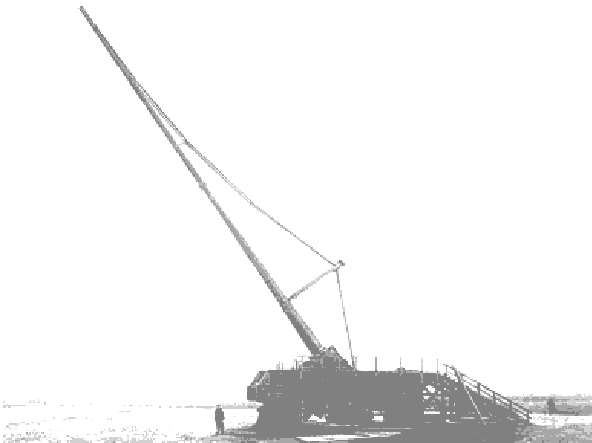
Souvent confondu à tort avec la Grosse Bertha le Canon de Paris est à la fois le plus célèbre et le plus mystérieux des canons de toute l'histoire de l'artillerie. Même les personnes les moins familières avec l'histoire contemporaine savent que Paris a été bombardé durant la Première Guerre mondiale par des canons géants de longue portée.
Tout commence aux environs de l'automne 1914, le Grand état-Major allemand espère encore que l'armée va poursuivre son avance le long de la côte de la Manche au-delà de Calais. Une telle avance offrait la possibilité de pilonner le port anglais de Douvres par l'artillerie de longue portée. La plus courte distance entre Douvres et la côte française se situe au cap Gris-Nez, au sud-ouest de Calais, où la largeur de la Manche est de l'ordre de 35 km. On envisagea donc d'utiliser des pièces d'artillerie navales de la Kriegsmarine modifiées pour atteindre de telles portées.
Au début de 1917, le haut commandement allemand réclame un canon à très longue portée qui pourrait, d'un point de la côte française, atteindre Londres et les quais de la Tamise. Et, pour faire d'une pierre deux coups, cette bouche à feu géante devait aussi pouvoir pilonner les ports français situés loin derrière le front, afin de perturber les opérations de débarquement des troupes et du matériel ou de gêner considérablement leur ravitaillement.
C'est le docteur Rausenberger, responsable du développement du canon chez Krupp, qui fut chargé de l'étude et de la réalisation du Wilhelmgeschutze (l'engin-à-Guillaume, l'arme-à-Guillaume), le nom officiel du Pariser Kanone. Si le professeur Rausenberger assumait la responsabilité générale du projet, sa direction technique relevait dans les faits du docteur Otto von Eberhard, appuyé par une équipe talentueuse qui maîtrisait parfaitement les techniques les plus avancées dans les domaines du génie mécanique et de la balistique interne.

Eberhard de 1916-1917 étudiera la possibilité d'utiliser un obus sous calibré à sabots.
Rausenberger refuse cependant d'utiliser cette technique novatrice dans le Canon de Paris en affirmant que le risque était trop grand d'avoir recours à une technique non éprouvée, technique qui allait pourtant se révéler par la suite comme la voie de prédilection du développement de l'artillerie. Pourtant, le premier tir expérimental, effectué sur le polygone d'Altenwalde, le 20 novembre 1917, démontre clairement les potentialités de ce type d'obus révolutionnaire. Des projectiles furent lancés à plus de 100 km. Malgré ces premiers résultats très encourageants, le directeur de l'artillerie de chez Krupp maintenait que l'utilisation de ce type de projectile allait soulever des problèmes insurmontables notamment parce que la séparation du sabot risquait de modifier la trajectoire de l'obus.
Cette approche ne sera réexpérimentée par les Allemands que 25 ans plus tard durant la Seconde Guerre mondiale. L'emploi des obus sous-calibrés à sabots s'étendra ensuite à toutes les armées du monde.
Pour développer son canon le Dr Rausenberger prit comme base la pièce allemande à longue portée la plus puissante du moment, le Long Max sur lequel on monta un canon de calibre réduit mais à tube allongé. Lange Max ( long Max ) SK-L/45 était une pièce d'artillerie de marine montée sur rail. D'un calibre de 380mm pour une longueur de 17m, sa portée avec des obus de xxt était de 60 km.
Les tubes des canons de Paris furent construits à partir des 9 tubes de marine de 350mm destinés au croiseur ERSATZ FREYA dont la construction avait été suspendue. Les tubes de marine de 17m ont été réalésés pour supprimer les rainures. A l'intérieur des tubes devenus lices était fretté (mise en place par dilatation) un tube rayé de calibre inférieur ( 210mm ) mais beaucoup plus long ( 30m ). Le canon fut encore rallongé par un tube prolongateur de 6m fixé à l'extrémité du premier. La longueur totale du tube atteinte était de 36m pour un poids entre 140 et 125T. La longueur et le poids exceptionnels du canon ont obligé les ingénieurs de la Krupp à concevoir un système de soutènement inédit en artillerie. Comme pour un pont suspendu des haubans et un mat central viennent rigidifier le long tube, l'empêchant de se courber sous son propre poids (plusieurs canons à long tube accusent d'ailleurs une courbe à peine perceptible que redresse momentanément la mise à feu). Après chaque coup de feu, le tube oscillait souvent plusieurs minutes.

Tir d'approbation de l'arme en présence du Kaiser
De par ses dimensions hors norme le canon ne pouvait être acheminé d'une seule pièce. Après avoir été déplacé par voie ferrée en pièces détachées, le canon était assemblé sur place au moyen d'un pont roulant. L'affût était préalablement débarrassé de ses bogies ferroviaires avant d'être monté sur un plateau tournant, le tube et sa prolongation étaient ensuite montés sur l'affût et enfin on déployait les haubans de soutènement. Ainsi montée la pièce atteignait le poids de 750 T.
Mais le secret des canons de Paris réside dans la trajectoire de l'obus. Avec une élévation égale à 50 degrés, le projectile est propulsé dans la haute atmosphère où l'air raréfié oppose moins de résistance à l'obus et accroît ainsi sa portée.
Le 30 janvier 1918 lors des essais finaux au pas de tir de la marine à Altenwalde le canon tira jusqu'à 126 km avec une assez bonne précision. Les obus ont atteint une altitude de 42 km à l'apogée de leur trajectoire.

Première implantation du canon de paris sur plate-forme métallique ettungsschiessgerüst construit dans une cuve bétonné
C'est à l'époque la plus haute altitude au-dessus de la surface de la Terre jamais atteinte par un projectile lancé par l'homme. Le Canon de Paris conserva ce record de 1918 à 1939, jusqu'à ce que la fusée V-2 soit mise au point durant la Seconde Guerre mondiale.
Le Canons de Paris tirait des projectiles explosifs de 210 mm. L'usure des tubes était telle qu'ils devaient être remplacés après 65 coups. Afin de compenser la détérioration extrêmement rapide de l'âme du canon, les obus étaient numérotés de 1 à 65 et devaient être tirés en ordre séquentiel puisque chaque projectile avait un calibre légèrement supérieur au précédent. Si bien que le calibre du projectile numéro 65 atteignait en fait 235 mm! La charge propulsive s'accroissait également à chaque coup, passant de 180 à 200kg pour un longueur approximative de 5m. Le plan initial prévoyait suffisamment de tubes de remplacement pour permettre le pilonnage continu de Paris par deux canons durant une année complète. Les tubes usés étaient retournés aux usines Krupp pour y être recalibrés à 210 mm. Un total de 7 tubes furent semble-t-il réalisés.
Cachés dans la forêt de Saint-Gobain, près de Crépy-en-Laonnois, au nord-est de Paris et 16 km derrière la ligne de front, deux monstres d'acier, en batterie à neuf cents mètres l'un de l'autre, commencent à pilonner la ville de Paris le 23 mars 1918 à 7 heures 15 du matin. Soit seulement deux jours après le début de l'offensive allemande contre la Cinquième Armée britannique à Amiens qui permit de conquérir les positions de tir. Une troisième bouche à feu se joignit à eux quelques jours plus tard. Les canons sont réglés sur le Palais de Justice sur l'île de la Cité dans le centre de Paris, pour une distance phénoménale de 121km. Une telle distance imposait d'ailleurs des calculs balistiques spéciaux incluant en autre la rotondité et la rotation de la terre. Une équipe de mathématiciens était spécialement venue de Berlin effectuer les calculs de pointage.

Ci dessus : montage du tube sur son affût.
Vers 7 h 17 avec un fracas qui est entendu dans tout le centre de Paris, un premier obus tombe sur la place de la République. Quinze minutes plus tard, à la grande consternation des Parisiens, une explosion de même intensité secoue de nouveau la capitale. Le projectile est tombé cette fois-ci rue Charles-V. Puis un troisième obus éclate boulevard de Strasbourg, à deux pas de la Gare de l'Est.
Ce 23 mars fatidique était une magnifique journée de printemps. Le Kaiser lui-même vint inspecter, vers 13 heures, les engins qui pilonnaient Paris depuis le matin. Le soir on dénombra 21 impacts sur Paris et 1 à Châtillon.
En quelques heures, cette nouvelle ahurissante du bombardement de Paris fait le tour du monde grâce au télégraphe et au téléphone. Partout l'information est reçue avec étonnement et incrédulité.
Le commandement allié, croyant dans un premier temps que ces bombes étaient dues à un assaut aérien d'avions ou de dirigeables agissant à très haute altitude, mobilisa la quasi-totalité de la chasse aérienne à investiguer l'espace aérien parisien aux plus hautes altitudes, ce qui ne donna strictement rien si ce n'est la perte d'un pilote américain qui perdit le contrôle de son avion et vint s'écraser en banlieue sud après avoir dépassé le plafond maximum !
|
|
L'aviateur René Fonck, écrit à propos du 23 mars 1918 : "L'après-midi, un message téléphonique annonçait que Paris était bombardé par canon, et chacun de rire tant la nouvelle paraissait invraisemblable. Je n'osais trop pour ma part, manifester mon sentiment. L'hypothèse d'un canon installé à plus de 120 kilomètres et posant son projectile aux environs de la gare de l'Est, semblait à tous franchement absurde ! Pourtant, comment croire à des avions en plein jour, semant des bombes durant toute la matinée et passant invisibles à travers une nuée de Spads disposés pour les arrêter ? Seule l'hypothèse du canon arrangeait tout, mais la portée de la pièce restait un phénomène inexpliqué."Dans les jours qui suivent, les journaux parisiens s'efforcent d'éclaircir le mystère et avancent diverses hypothèses. Pour certains, les obus sont tirés par des canons dissimulés dans des carrières abandonnées ou des secteurs densément boisés de la région parisienne. Pour d'autres, les projectiles sont tirés par un canon pneumatique silencieux installé au cœur même de la capitale ! Des recherches furent d'ailleurs entreprises dans la région de Paris par des journalistes et des militaires pour trouver où se cachaient ces fameux canons |
Entre temps bien qu'un épais brouillard matinal recouvre le site, empêchant tout repérage visuel, les Français basés sur les hauteurs de Fourdrain purent repérer au son l'emplacement d'une nouvelle pièce d'artillerie.
Le 24 mars, alors que le docteur Rausenberger discute de la réussite du projet avec son équipe rassemblée dans la clairière, des obus français se mettent à pleuvoir ! Les premiers éclatent à quelque 200 mètres de distance sans toutefois faire de blessés, mais un projectile de la troisième ou quatrième salve percute un arbre, explose et blesse six ou sept artilleurs du canon numéro un. Durant la période où les canons furent à Crépy, les Français tirèrent ainsi une centaine d'obus contre la batterie sans parvenir à causer d'autres pertes.
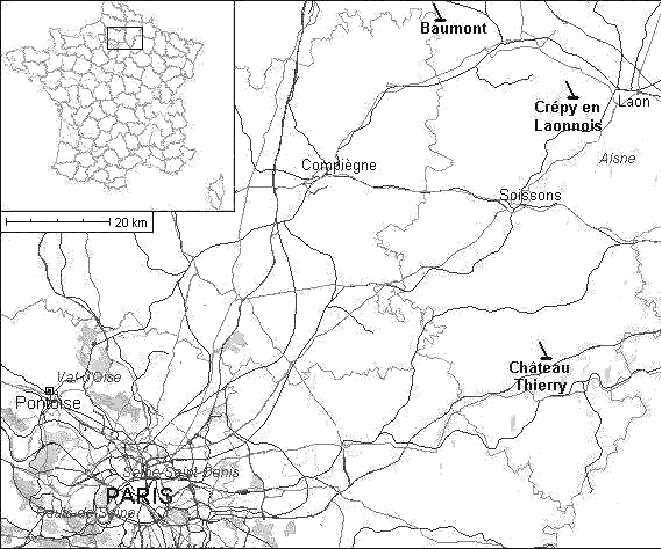
Des bombardements aériens et des tirs de contre-batterie sur la forêt de Saint-Gobain par des canons de 320 mm montés sur chemin de fer de l'Armée française ne réussirent jamais à réduire au silence l'arme secrète.
Toutefois, après le début du pilonnage de Paris, un grave accident fit plusieurs victimes. Un obus explosa à l'intérieur du tube et fit éclater le canon.
Lorsque le front allemand s'avance vers Paris durant l'offensive du printemps 1918, les canons géants suivent. Le premier mai 1918 les canons sont retirés de la forêt de Saint Gobain après avoir tiré 185 obus et sont transférés à Beaumont en Beine dans le bois de Corbie à 109 km de Paris. Du 27 mai au 11 juin 1918 les canons tireront 104 obus de cette position avant d'être démontés à nouveau et transférés à 15 km au nord de Château-Thierry dans le Bois de Bruyère à Frère en Tardenois, situé seulement à 91 km de la capitale. Cette position rapprochée entraînait une diminution de la puissance des charges propulsives et, par conséquent, de l'usure des tubes des canons. Cependant les Allemands furent rapidement délogés de cette position où les canons ne tirèrent que 14 obus entre le 16 et 17 juillet 1918. En effet devant la contre-offensive alliée (2ème bataille de la Marne) de juillet 1918 les canons furent précipitamment démontés et réexpédiés à Beaumont en Beine ou 64 obus furent encore tirés du 5 au 9 août 1918.
Au total c'est plus de 400 obus qui furent tirés dont 367 impacts recensés. 351 obus atteignirent la ville de Paris pendant plus de quatre mois avec un épisode tragique le 29 mars 1918 à 16 h 27, lorsqu'un obus sectionna le deuxième pilier de la face nord de l'église Saint-Gervais près de l'hôtel de Ville, provoquant l'effondrement de la voûte, en plein office du Vendredi-Saint, causant la mort de 91 fidèles et en blessant 68 autres. Le 9 août, à 15 heures 30, le dernier projectile fut tiré en direction de Paris. Au cours de cette période, huit tubes furent utilisés sur les trois affûts. Les Canons de Paris auront tiré 351 obus sur la ville, d'une distance maximale de 121 km, causant ainsi la mort de 256 personnes et en blessant 620
VII - Le Bois de Bruyères
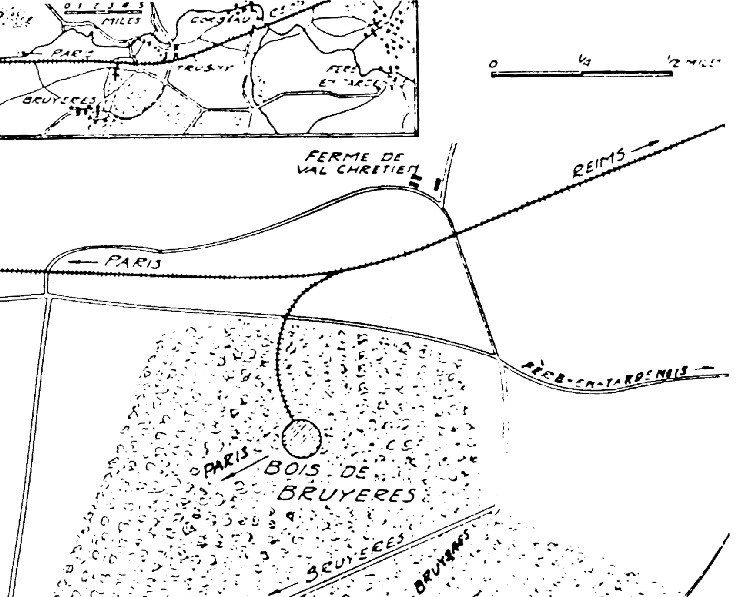
Emplacement supposé du " super-canon " descendu de Crépy-en-Laonnois et installé dans le Bois de Bruyères, près de la Ferme de Val-Chrétien, non loin de Fère-en-Tardenois, destiné à tirer sur Paris à une distance de 84 kilomètres.

Pause repas à Bruyères